Hélène Artaud, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Nous vous proposons de découvrir un extrait de l’ouvrage de l’anthropologue Hélène Artaud (Muséum national d’histoire naturelle), « Immersion », paru le 23 février 2023 aux éditions La Découverte. L’autrice y explore les rapports profondément différents que les sociétés de l’Atlantique et du Pacifique ont entretenus avec la mer. Et comment la rencontre de ces deux mondes a bouleversé les représentations occidentales des espaces maritimes. Dans le passage choisi ci-dessous, elle revient sur les changements qui se sont opérés au siècle dernier dans la perception de la faune océanique.
La reconnaissance d’une sensibilité animale apparaît avec une acuité sans précédent au tournant du XXe siècle ; elle se double d’un enjeu éthique, d’une responsabilité à l’égard d’existants désormais perçus comme des sujets.
Si l’urgence à changer en profondeur notre relation aux espèces marines pouvait être signalée dans les récits d’observateurs avant le XXe siècle – comme dans cette remarque de Jules Michelet qui s’émeut du traitement infligé à certaines espèces marines et réclame « la paix pour la baleine franche ; la paix pour le dugong, le morse, le lamantin » –, l’expression d’une émotion nouvelle se fait plus massive et radicale au tournant des années 1970.
Une forme de biophilie gagne l’espace océanique où un « profond changement dans la perception des animaux » est à l’œuvre. Avec l’émergence du cinéma documentaire et d’un tourisme maritime orientés vers la faune sauvage, les sentiments d’hostilité qu’éveillaient jusqu’alors les espèces marines s’émoussent. La visualisation des profondeurs océaniques n’est pas étrangère à ce bouleversement.
L’exploration des fonds sous-marins ouvre la possibilité d’une rencontre avec des existants dont les comportements et les aptitudes désormais visibles tranchent avec la menace et l’anonymat qu’ils incarnaient jusque-là. Plutôt que l’étrangeté, c’est bien au contraire l’identification avec certains d’entre eux qui semble alors s’imposer. Des caractéristiques morphologiques propres à la mégafaune marine facilitent sans doute un tel basculement.
Par le support de projection anthropomorphique privilégié qu’elles autorisent dans un monde qui continue par ailleurs de présenter une tonalité d’altérité et d’opacité fondamentales, les baleines ou les dauphins apparaissent comme des partenaires privilégiés. Leur regard, « exagérément humain », fait partie des éléments les plus remarquables. L’anecdote que mobilise Lévi-Strauss, qui rapporte dans La Pensée sauvage le récit de Hediger, directeur des jardins zoologiques de Zurich, en est un bon exemple. Ce dernier décrit « son premier tête-à-tête […] avec un dauphin » en revenant à de nombreuses reprises sur le regard « pétillant » de l’animal dont l’intensité avait troublé le narrateur au point de lui faire « se demander [s’il s’agissait] vraiment [d’]un animal ».
L’importance du regard dans la rencontre interspécifique est souvent mentionnée. Dans l’évènement que le militant écologiste Paul Watson qualifie de décisif pour son engagement « combatif » en faveur des baleines, l’intentionnalité qu’il impute à l’animal rencontré lors d’une campagne menée contre les baleiniers soviétiques en 1975 se révèle là encore par ce biais.
« Alors qu’il se glissait à nouveau dans l’eau, se noyant dans son propre sang, j’ai regardé dans ses yeux et j’ai vu de la reconnaissance. De l’empathie. Ce que j’ai vu dans ses yeux lorsqu’il m’a regardé allait changer ma vie pour toujours. Il a sauvé ma vie et j’ai voulu lui rendre la pareille. »
Le « tournant affectif » ciblant les espèces marines semble submerger de façon si globale la société civile que les politiques de conservation envisagent sérieusement les conséquences favorables que pourrait avoir sur la biodiversité l’utilisation de ces viviers émotionnels, et élaborent en conséquence des catégories spécifiques, notamment celles d’espèces « phares ou emblématiques », supposées capter l’adhésion sensible du public. Ces icônes visibles de la conservation sont « des espèces populaires et charismatiques qui servent comme symboles et points de ralliement pour stimuler la sensibilisation et l’action en matière de conservation ».
L’importance croissante que revêt la dimension affective dans le cadre écologique ne concerne pas seulement un public à sensibiliser et éduquer. Elle cible aussi les scientifiques. Si le récit de la rencontre avec le dauphin se concluait dans les années 1955 – date de l’ouvrage de Hediger dans lequel Lévi-Strauss a puisé cette anecdote – par cette sentence : « Hélas, le cerveau du zoologiste ne pouvait [dépasser] la certitude glacée, presque douloureuse en cette circonstance, qu’en termes scientifiques il n’y avait rien là que Tursiops truncatus… », émotion, affects et régime de scientificité semblent en revanche se rejoindre de façon moins problématique quelques années plus tard.
Gérard Collomb en donne un exemple éloquent en indiquant que les mesures toutes particulières de conservation et l’interdiction de prélever des tortues en Guyane ont, en partie, pour origine des principes émotionnels. À la fin des années 1960, alors que l’on ne disposait pas encore de données quantifiées susceptibles de confirmer un déclin des populations de tortues marines, c’est dans ce sillon émotionnel, encore inavouable, que s’inscrivait la démarche du biologiste Peter Pritchard, pionnier de l’étude et de la conservation des tortues marines. Visitant les plages vierges de la Guyane, il écrivait avoir « trouvé […] la plage jonchée des carcasses et des crânes de pas moins de quatre espèces de tortues marines » et il s’exclamait : « J’ai été horrifié par ce massacre et j’ai fait un rapport à plusieurs personnes, y compris à plusieurs fonctionnaires du gouvernement. »
Collomb commente :
« Cette dimension sensible (I was horrified by the slaughter) représentera jusqu’à aujourd’hui, dans le rapport que l’on entretient avec cet animal hors du commun, une constante que l’on retrouve à l’arrière-plan de nombre de professions de foi conservationnistes. »
La déferlante affective va profondément renouveler les principes et méthodologies scientifiques dans le sens d’un rapprochement corporel inédit avec l’animal aquatique. Le géographe Jamie Lorimer qualifie d’« épiphanie interspécifique » la façon dont le scientifique va prendre part de façon affective et empathique, mais également corporelle et sensitive, au monde de l’espèce qu’il rencontre, en se « re-territorialisant ». Ce renversement est sans précédent dans « la pratique de l’histoire naturelle […] qui consiste à s’adapter ou à “apprendre à être affecté” (Hinchliffe et al, 2005 ; Latour, 2004) par l’organisme ciblé, ou même à “devenir animal” (Deleuze et Guattari, 1987) ».
L’idée que le scientifique puisse non seulement éprouver de l’empathie pour son objet d’étude, mais être de façon sensorielle et subjective impliqué dans le processus expérimental revient en force dans la littérature scientifique de ces dernières années. C’est sur cette dimension intime de l’histoire scientifique que s’interrogent Véronique Servais, James Latimer et Mara Miele ou Vinciane Despret. Revenant sur l’implication corporelle corrélée à ce principe empathique, cette dernière évoque un aspect souvent négligé de cette dimension sensible qui lie le scientifique à son sujet d’étude. Elle prend à rebours l’idée selon laquelle la démarche scientifique et la qualité de l’expérimentation dépendraient de la capacité de l’observateur à se mettre en retrait, à réduire au mieux les éléments subjectifs susceptibles d’interférer dans les observations.
Elle choisit au contraire de porter la lumière sur les transformations et ajustements constants qu’opère le corps du scientifique pour rencontrer l’animal. Comprendre son environnement sensible, son Umwelt, implique de transformer d’abord son corps. Despret raconte que des éthologues, « pour s’engager avec les animaux qu’ils étudiaient », soumettent « leur corps à un processus qui prend la forme d’une expérience transformatrice ». Elle constate que cette métamorphose est facilitée lorsque le monde sensoriel de l’espèce est proche de celui de l’homme. Plus les affordances sont partagées, plus le basculement d’un monde vers l’autre est aisé. Elle explique « l’attrait largement partagé pour les oiseaux, les papillons et les fleurs au Royaume-Uni » par « les modes de communication intertaxa et intrataxon qu’ils partagent avec les humains. Sur certains “plans de cohérence” (Deleuze et Guattari, 1987), les humains, les oiseaux et les papillons sont organisés de manière similaire […] ceci explique la spontanéité avec laquelle ils ont fait l’objet de surveillance et de recherche de la part des historiens de la nature ».
Si l’empathie s’avère donc possible et le rapprochement sensible facilité avec un animal dont les mondes sont apparentés, qu’en est-il des espèces marines ?
C’est la question que pose Eva Hayward qui reconnaît que, « pour la mégafaune charismatique – chiens, chevaux, chats, dauphins – sur laquelle nous pouvons cartographier notre corps », une projection empathique est envisageable, mais s’interroge sur la possibilité de le faire avec « des organismes comme les méduses, le corail ou les poulpes, [dont] les différences corporelles écrasantes font de l’identification une politique d’effacement plutôt que d’empathie ». La tâche s’avère en effet plus complexe lorsque l’étrangeté anatomique déjoue toute analogie, ou lorsque l’éloignement organique et physique entre le monde du chercheur et celui de l’espèce est maximal comme dans le cas de « l’inaccessible écologie benthique ou l’anatomie microscopique et indistincte des nématodes des grands fonds ».
Or, force est de constater que même sur ces espèces a priori lointaines s’engage ces dernières années un renouveau sensible que l’anthropologue Stefan Helmreich a largement souligné en prenant l’exemple des microbes ou celui du corail, passé en l’espace d’un siècle à peine « d’os à chair » (from bones to flesh).
C’est à l’acte d’immersion que l’auteur attribue ce changement et le fait que le corail ait pris consistance et vie : il n’est plus simplement un idéal statique, mais une entité vivante. Il précise et corrèle à la pratique de l’immersion les raisons de ce bouleversement esthésique radical :
« Là où Darwin et d’autres ont principalement rencontré des fragments de corail mort, et ont imaginé ces formes sculpturales et sépulcrales presque comme des artefacts archéologiques, les naturalistes du XXe siècle cherchent à immerger leurs corps et leurs yeux au milieu des communautés coralliennes. »
Le corail n’est plus une métaphore abstraite, mais un sujet qui prend corps grâce à l’immersion. C’est l’immersion, nécessaire à l’observation et au prélèvement des cellules par les océanographes et biologistes marins, qui fait passer le corps du chercheur de la surface vers les profondeurs, d’un regard éloigné à un corps impliqué. Ce que l’auteur qualifie de « changement de paradigme » tiendrait donc à la possibilité, inédite pour le chercheur, de s’immerger, soit de se relier à des existants dont l’altérité emblématique s’estompe par paliers.
Le monde des biologistes marins subit, quoique de façon encore inégale, un bouleversement notable. Le basculement du regard « des mammifères et des poissons vers les microbes » révèle le passage d’une posture ontologique, caractérisée par une perspective de « surplomb de l’homme sur une nature distante » à une adhérence incarnée de l’homme dans le monde. Cet attrait croissant pour les être immergés, jadis invisibles, indique quelque chose des mutations qui s’opèrent dans la perspective atlantique.
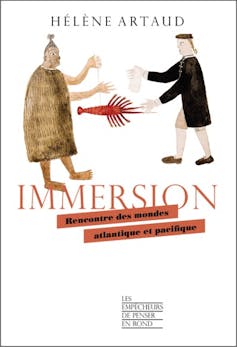
C’est ce que relève Helmreich quand il se demande si les baleines qui constituaient « les mascottes marines […] du XIXe siècle, [et le] dauphin [celle] du XXe siècle » ne seraient pas supplantés au XXIe siècle par les microbes et cherche à comprendre « comment la mer microbienne réorganise ou reconfigure les anciennes conceptions de l’océan […] en tant que région sauvage sublime ou en tant que frontière sociale, économique et scientifique ». Même dans ces mondes paradigmatiques de la nature sauvage se loge désormais une partie de l’humain. Même pour ce monde microbien sans visage, sans forme, sans regard, une tendance à l’empathie se manifeste, comme en témoigne le travail des artistes Mick Lorusso et Joel Ong qui proposent que, « par l’exposition à ce processus de recherche artistique, [leur] public puisse également adopter une responsabilité écologique/morale par une empathie et un respect partagé avec le monde microbien ».
Hélène Artaud, Maître de conférences, en anthropologie sociale, UMR 208 Paloc, MNHN, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.